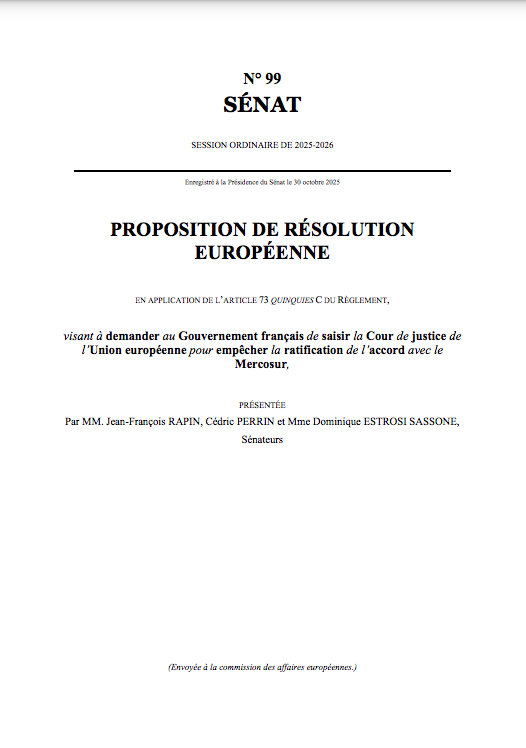
Mercredi 26 novembre dernier, en commission des Affaires étrangères du Sénat, j’ai eu la charge de rapporter sur le projet de résolution européenne, déposé par mes collègues sénateurs Jean-François Rapin, Dominique Estrosi Sassone et Cédric Perrin, qui demande au Gouvernement de saisir la Cour de Justice de l’Union européenne pour empêcher la ratification de l’accord avec le Mercosur.
Le Mercosur, on en a tous entendu parler, nous sommes globalement en France TOUS contre. Mais parfois cela ne suffit pas gagner. Il faut continuer le combat, toujours.
Revenons sur le détail de cet accord, dont les négociations ont débuté en 1999, et qui a vocation à succéder à un accord-cadre conclu en 1995…
Côté Mercosur, il prévoit une libéralisation de 91 % des droits de douane sur les importations en provenance de l’Union européenne (UE). Pour les produits non entièrement libéralisés, le Mercosur devra accorder un accès supplémentaire au marché sous forme de réductions tarifaires supplémentaires ou de contingents tarifaires : 30 000 tonnes pour les fromages, 10 000 tonnes pour le lait en poudre ou encore 5 000 tonnes pour le lait infantile. L’accord prévoit également la reconnaissance de 350 indications géographiques européennes.
Côté européen, la mise en oeuvre de l’accord se traduira par la suppression de 92 % des droits de douane. Pour les produits non entièrement libéralisés, l’UE accordera également des contingents tarifaires ou des réductions partielles. Cela concernera notamment les produits agricoles, avec des quotas de 99 000 tonnes de boeuf au taux de 7,5 %, 180 000 tonnes de volaille, 16 millions de tonnes de sucre, 450 000 tonnes d’éthanol destiné à l’industrie chimique et 60 000 tonnes de riz en franchise de droits. Certaines exclusions sont toutefois prévues, notamment pour le blé et la viande ovine.
En matière de marchés publics, les parties s’engagent à ouvrir les appels d’offres aux entreprises de l’autre continent.
Au total, selon une étude de la Commission européenne de 2025, la mise en oeuvre de l’accord entraînerait une hausse de 39 % des exportations européennes vers le Mercosur, avec des gains particulièrement importants dans les secteurs de l’automobile, des machines et équipements ou encore de la chimie.
De leur côté, les exportations du Mercosur vers l’UE progresseraient de 16,9 %. Globalement, l’accord augmenterait le PIB de l’UE de 0,05 % et celui du Mercosur de 0,25 % d’ici à 2040.
À la suite de la remise du rapport de la commission d’évaluation du projet d’accord UE-Mercosur en 2020, le Gouvernement a indiqué que la France ne pourrait approuver cet accord qu’à trois conditions :
- qu’il n’entraîne pas d’augmentation de la déforestation importée au sein de l’Union ;
- que les politiques publiques des pays du Mercosur soient pleinement conformes à leurs engagements au titre de l’accord de Paris ;
- enfin, que les produits agroalimentaires bénéficiant d’un accès préférentiel au marché européen respectent, en droit comme en pratique, les normes sanitaires et environnementales de l’Union.
En dépit des modifications apportées à la première version de l’accord, force est de constater que ces lignes rouges françaises n’ont été que très partiellement respectées.
Certes, l’accord de Paris est désormais un élément essentiel de l’accord de partenariat UE-Mercosur et de l’accord commercial intérimaire, qui prévoit, en cas de retrait ou de non-application « de bonne foi » de l’accord de Paris, une possibilité de suspendre l’accord avec le Mercosur. Le caractère flou de la notion de « partie de bonne foi » ouvre toutefois la porte à des divergences d’interprétation.
Par ailleurs, le chapitre « Commerce et développement durable » a été complété par une annexe prévoyant des engagements en matière de lutte contre la déforestation. Bien que juridiquement contraignants, ces engagements ne sont cependant assortis d’aucune sanction commerciale, ce qui en limite la portée.
Surtout, en contrepartie de ces ajouts, les États du Mercosur ont obtenu la création d’un « mécanisme de rééquilibrage », permettant à une partie de demander une compensation si elle estime qu’une mesure prise par l’autre porterait atteinte aux avantages prévus par l’accord.
Or la notion même de « mesure » fait l’objet d’interprétations divergentes et, comme le souligne le projet de résolution, ce mécanisme pourrait limiter la capacité de l’UE à adopter de nouvelles normes environnementales, en contradiction avec plusieurs dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), de la Charte des droits fondamentaux, mais également avec les principes d’autonomie de l’ordre juridique de l’Union européenne et de sécurité juridique.
En droit national, l’effet dissuasif de ce mécanisme pourrait en outre constituer une atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale et, par conséquent, être contraire à notre Constitution.
Concernant le principe de précaution, s’il est bien mentionné, son champ d’application apparaît très restreint : il ne couvre explicitement ni la sécurité sanitaire des aliments ni la santé humaine.
Enfin – et c’est un point majeur -, sauf exception pour certains règlements européens dotés d’un article « miroir », comme l’interdiction des antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance, les règles européennes de production ne seront pas imposées aux importations provenant du Mercosur.
Cette situation, source de distorsion de concurrence au détriment de nos agriculteurs, n’est pas acceptable.
Le contenu de l’accord entre l’UE et le Mercosur est contestable en soi, notamment au regard des risques qu’il comporte pour l’environnement et pour l’agriculture européenne.
Mais, au-delà de ces enjeux de fond, la procédure de ratification retenue par la Commission européenne fragilise la légitimité démocratique de l’accord UE-Mercosur et sa légalité doit, selon nous, être examinée par la CJUE.
Tout d’abord, malgré l’opposition exprimée par plusieurs États membres, dont l’Autriche, l’Irlande, les Pays-Bas, la Pologne et la France, la Commission européenne a choisi d’aller au bout des négociations, de manière précipitée, fin 2024.
Alors que l’accord était discuté depuis 1999, et que des échanges se poursuivaient encore en 2023 et 2024 sur un instrument additionnel concernant le développement durable, Ursula von der Leyen a décidé de conclure les négociations le 6 décembre 2024 à Montevideo. C’est un passage en force, qui a ignoré les réserves exprimées par plusieurs gouvernements.
Ensuite, la Commission a décidé de « scinder » l’accord, alors même que cela ne correspond pas au mandat fixé par le Conseil.
En 1999, celui-ci avait demandé la négociation d’un accord d’association – c’est-à-dire commercial et politique – relevant à la fois des compétences exclusives et partagées. Il avait même rappelé en 2018 que les accords avec le Mexique, le Mercosur ou le Chili devaient rester des accords mixtes, devant par conséquent être ratifiés par l’ensemble des États membres.
Pourtant, le 3 septembre 2025, la Commission a présenté deux textes séparés : un accord de partenariat incluant les volets politique et commercial, et un accord commercial intérimaire, centré uniquement sur la libéralisation des échanges. Ce faisant, elle s’est écartée du mandat de négociation que lui avait confié le Conseil sur deux points essentiels.
D’une part, elle a transformé l’accord intérimaire en véritable accord autonome, alors qu’il ne devait être qu’un auxiliaire de l’accord d’association.
D’autre part, elle a proposé la signature et la conclusion d’un accord de partenariat et non d’un accord d’association, comme le prévoyait le mandat de négociation de 1999. Or l’accord d’association est une catégorie juridique particulière prévue à l’article 217 du TFUE, dont la procédure au Conseil requiert l’unanimité.
En d’autres termes, la Commission européenne a modifié, de sa propre initiative, la base légale de l’accord qu’elle a négocié pour pouvoir éviter un éventuel veto d’un État membre.
Au fond, cette scission vise à contourner les Parlements nationaux et les États membres : le volet commercial pourrait s’appliquer quand bien même un ou plusieurs États refuseraient de ratifier l’accord de partenariat.
En affaiblissant ainsi le rôle des États membres, cette méthode réduit encore un peu plus l’assise démocratique d’un accord déjà largement contesté par l’opinion publique.
D’un point de vue juridique, cette démarche soulève de nombreux doutes. Comme le rappelle le projet de résolution, elle pourrait contrevenir aux principes d’attribution, d’équilibre institutionnel et de coopération loyale prévus par les traités.
S’y ajoutent les interrogations sur le principe de précaution, ainsi que sur le mécanisme de rééquilibrage, qui pourrait limiter la capacité de l’Union à prendre de nouvelles mesures environnementales.
C’est pourquoi nous estimons qu’il est politiquement et juridiquement justifié de saisir la Cour de Justice de l’Union européenne, conformément à l’article 218, alinéa 11 du TFUE. La CJUE pourra alors dire si ces accords sont compatibles ou non avec les traités.
D’ailleurs, 145 eurodéputés issus de 5 groupes et de 21 nationalités avaient déjà demandé cette saisine le 14 novembre dernier. Il est regrettable que cette proposition de résolution de nos collègues eurodéputés n’ait pas été inscrite à l’ordre du jour du Parlement européen, au motif que la procédure n’en était pas encore au stade du Parlement.
La balle est donc désormais dans le camp des États membres, qui ont la possibilité de saisir la Cour de Justice de l’Union européenne sur ces différentes questions.
