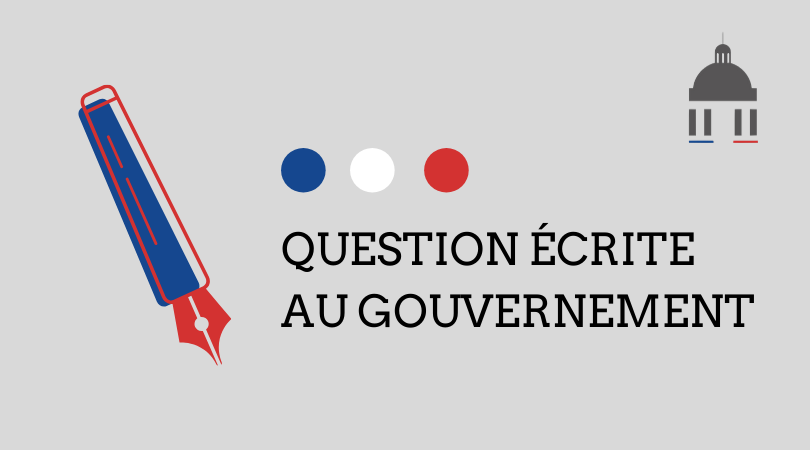La mission d’information « L’accès aux services publics : renforcer et rénover le lien de confiance entre les administrations et les usagers » a rendu ses conclusions ce mardi.
Face à une dématérialisation des services publics qui
s’impose désormais dans de nombreuses démarches, la mission fait le constat de fractures persistantes qui sont autant de difficultés et de contraintes pour certains usagers, malgré les avancées réalisées au cours des dernières années pour améliorer l’accès aux services publics.